Comédie – entretiens

Affirmer une position ne suffit pas : il est nécessaire d’argumenter – Entretien avec Michel Badré
Michel Badré a été directeur de l’Office national des Forêts, membre de la Commission Particulière du Débat Public sur la gestion des déchets et des matières radioactives, médiateur dans le cadre du conflit de Notre-Dame des Landes et membre du groupe Environnement et Nature de la précédente mandature du Conseil économique social et environnemental (CESE).
Entretien réalisé par Julie Riegel dans le cadre du projet Sciences-Société sur le dialogue des savoirs mené par Comédie (2021).
Vous avez contribué pour la Commission Nationale du Débat Public à préparer et animer le Débat public national sur la gestion des déchets et des matières radioactives. Pour cela, vous avez réalisé en amont du débat public une clarification des controverses techniques. De quoi s’agit-il ?
En 2018, lors de la préparation de ce Débat Public, nous nous sommes rendu compte combien le sujet était technique et compliqué. Pour faire venir le public, il fallait mettre à sa disposition des informations claires et éviter un face à face d’experts.
Avec un jeune ingénieur spécialiste de physique quantique, nous avons épluché la documentation disponible : quels étaient les thèmes controversés ? Par exemple en ce qui concerne le projet Cigeo à Bure, certains estiment qu’il faut garder les déchets à portée de main pour pouvoir éventuellement les reconditionner, les traiter ou les réutiliser, tandis que d’autres prônent de les enterrer définitivement.
Nous avons ainsi trouvé sept exemples de controverses sur des questions techniques. Puis, nous avons décidé de réunir les experts sur chaque question, en leur imposant une méthode assez rigide : rédiger une fiche recto/verso sur leurs arguments, faisant elle-même l’objet d’une contre-argumentation et vice-versa.
Ce travail s’est déroulé en même temps qu’a surgi le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a ralenti le processus… Mais cela a permis, en même temps, aux personnes de se connaître, et donc d’être moins agressives. Ensuite, nous avons produit une synthèse, que nous avons faite valider par tous les membres, qui l’ont discutée mot par mot ! Cela a été laborieux mais positif : à la fin, tous les experts ont exprimé leur contentement. Et pendant le débat public, ils ont fait souvent référence à ce document de quinze pages[2].
Pourquoi ne pas avoir pris en compte les controverses éthiques et politiques ?
Il est évident que de nombreuses questions éthiques sont mêlées aux questions techniques : comme par exemple le bien-être des générations futures. Notre objectif était justement que le débat éthique ne soit pas pollué par les questions techniques : si ces dernières sont éclaircies, si le terrain est déblayé, on peut passer aux vraies questions. Quand on se confronte à un sujet très complexe du type « Faut-il enterrer des déchets nucléaires ou pas ? », cela pose notamment des questions d’étanchéité, qui concernent les experts géologues. Ils peuvent dire « oui on sait faire » ou « non on ne sait pas ». Mais ce n’est pas parce qu’on sait faire quelque chose qu’il faut le faire. Le déblocage technique préalable est cependant utile.
Dans un Débat public, qu’est-ce qui pour vous est un argument recevable et non recevable ?
Cette question est plus délicate ! Dans l’exemple précédent, avec notre système de fiches sur les controverses techniques, nous disions aux gens : « pourquoi êtes-vous pour le stockage géologique profond ? Avec quels arguments ? ». Affirmer une position ne suffit pas : nous demandons aux participants d’argumenter. Les domaines techniques et scientifiques s’appuient sur des expériences et des démonstrations. Par exemple, des photos de la Terre montrent qu’elle est ronde. Mais dans le cas de l’enfouissement des déchets nucléaires, est-ce que la couche d’argile à – 500 mètres de profondeur – est complètement imperméable à l’eau ? Que veut dire imperméable ? Est-ce que cela porte sur 10 jours ou 10 000 ans ? Y a t-il des expériences existantes, une revue scientifique mondiale ?
Dire qu’un argument est non recevable, c’est facile. Dire qu’il est recevable est beaucoup plus difficile. Les disciplines physiques progressent de l’incertitude à la certitude, mais il y a des sujets où les travaux de recherche sont en cours : les débats publics sur des sujets non stabilisés sont alors complexes.
Actuellement, je préside une Commission mise en place après ce Débat public, car le maître d’ouvrage du plan national sur les déchets nucléaires doit maintenant décider quoi faire. Dans cette commission il y a des personnes radicalement pour et d’autres radicalement contre.
Mon rôle est de mettre en évidence les directions communes qui sont agréées par tout le monde, de discerner les questions sur lesquelles il n’y a pas de consensus et d’énoncer les différents choix possibles.
Quand nous avons mis cette commission en place, nous avons écrit son règlement intérieur : il stipule que tous les avis sont rendus publics. C’est important pour la transparence et la confiance dans le débat.
Trouvez vous que la distinction souvent mise en avant entre connaissance et opinion à du sens ?
Prenons un exemple qui m’est familier, étant ingénieur forestier de formation, et ancien directeur de l’ONF : un technicien forestier peut faire des analyses techniques sur la faisabilité d’une plantation de chênes, en place d’un vieux taillis de charme. La connaissance permet de dire ce qui est possible, ou pas, et à quelles conditions. Mais savoir s’il faut laisser ce taillis existant en libre-évolution, ou plutôt le remplacer par des chênes de plus haute valeur économique, cela relève de deux opinions, qui reposent sur des préoccupations et des valeurs différentes. Je m’interdis de parler d’experts indépendants : cela n’a aucun sens, je ne connais aucun expert, dans aucun domaine, qui n’ait son opinion personnelle. C’est heureux et parfaitement naturel !
Lorsque j’ai été missionné comme médiateur pour le conflit d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, notre équipe s’est immédiatement fait attaquer sur sa non-indépendance. Notamment, pour ma part, car je fais partie de l’association Humanité et Biodiversité. J’ai répondu à cela que la procédure d’expertise peut offrir des garanties d’indépendance, grâce à une pluralité des experts et des avis, qui soient rendus publics et soumis à la critique.
Est ce qu’il est pertinent, et toujours possible, de dissocier des arguments techniques des valeurs des personnes qui s’expriment ?
C’est plus facile, quand on n’est pas issu d’un champ d’expertise, d’avoir conscience de ce qui relève d’un argument technique et de choix personnels. Pour ma part, je les distingue mieux dans le champ du nucléaire que de la forêt. Mais le propre d’un ingénieur, c’est d’apporter des solutions à des problèmes qu’on lui pose. Il a envie d’être rapide, efficace. Quand on lui dit qu’il faut écouter, prendre le temps… c’est un choc des cultures.
Au regard de votre expérience, avez vous constaté que le débat public peut faire évoluer les perceptions politiques et éthiques d’un problème, donc faire bouger les valeurs ?
Il y a de nombreuses démarches de débat public, ou encore la Convention citoyenne pour le climat et différentes formes de participation à l’élaboration de la décision… Je ne suis pas certain que leur but soit de faire évoluer les valeurs des gens. Et qui suis-je pour prétendre avoir le droit de faire bouger les valeurs des uns ou des autres ? Ce sont les accidents de la vie, ou la vie tout court, qui les façonnent. Ce que la discussion publique peut modifier, ce sont les perceptions, en permettant d’écouter ceux d’en face, en amenant à réfléchir, à avancer. Un syndicaliste m’a dit : « La démocratie, c’est le fait d’être capable de vivre ensemble avec des idées différentes ». Quelles sont ces différentes idées ? Et pourquoi sont-elles différentes ? On peut progresser sur la connaissance d’un problème, tout en conservant ses idées. En matière de choix énergétiques, la lutte contre la pauvreté actuelle a autant de valeur que le bien-vivre des générations futures. Je peux porter les mêmes valeurs, mais mieux comprendre que d’autres questions comptent aussi. Et dire que ces différentes questions existent, cela éclaire tout le monde.
Je voudrais ajouter qu’en apparence je peux avoir l’air d’avoir des réponses, mais que tout ça n’est pas si clair en pratique ! Et je me pose une question sourde depuis mon expérience à Notre-Dame-des-Landes. C’est celle de la violence de la société. Notre-Dame-des-Landes était une controverse technique, qui est devenue une guerre civile. Dans un pays avec des procédures, une démocratie, les gens en étaient à s’entre-tuer. Durant toute ma mission de médiation, je me suis demandé comment éviter qu’il y ait vingt-cinq morts ? Nous parlons de Débat public, de techniques de participation, de procédures… Mais de temps en temps, la société a des jets de vapeur, comme avec les Gilets jaunes. Est-ce que nos procédures suffiront ?
___
[1] Cigeo est un projet d’enfouissement profond de déchets radioactifs à vie longue.
[2] Ce document est disponible sur le site de la CNDP.
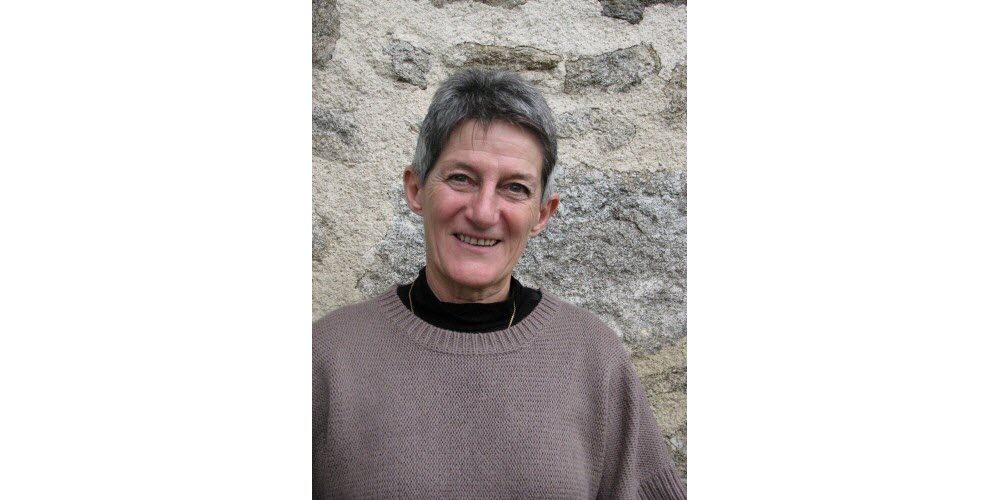
La bonne démarche, c’est de faire avec les gens de terrain – Entretien avec Josette Leroy
Réalisé par Hélène Cauchoix
Josette Leroy a été Maire de Saint Victor sur Arlanc (Haute Loire). Elle a notamment impulsé un inventaire participatif des zones humides sur la commune. Voir également cet entretien en vidéo.
Pour moi, la bonne démarche, c’est de faire avec les gens de terrain. Car ce sont eux qui vivent et voient les évolutions : ce qui est en train de se passer et ce qui est en train d’être détruit. Il vaut mieux prendre le temps de faire travailler les gens et de le leur faire découvrir par eux-mêmes.
Je suis dans une région où l’eau du réseau a été installée dans les années 1960. J’ai pris le temps de lire les anciens comptes-rendus municipaux pour voir ce qui se faisait. Jusque-là, il y avait une protection de l’eau et des puits. Par exemple, des précautions avec le pacage des moutons ou des oies autour des puits. Et puis l’eau est arrivée au robinet et on n’a plus fait attention à rien. On n’a plus fait attention aux ressources, à ce qu’on avait sur place.
C’est vrai que je buvais de l’eau de source à l’époque. J’ai fait des examens et il y avait un tel niveau de nitrate que ce n’était plus potable. J’ai eu envie de faire bouger les choses. Parler des nitrates avec les gens, c’est compliqué. C’est quelque chose qui ne se voit pas, qui n’a pas d’odeur, qui n’a pas de couleur. On ne peut pas se rendre compte des conséquences sur la santé. Je ne l’ai pas dit, mais professionnellement, j’étais dans le domaine de la santé.
Dans un premier temps, je voulais qu’on puisse dire ce qu’on voit, ce qui nous semblait dangereux. À mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose. Je voulais savoir s’il pouvait y avoir une réglementation qui protège. Ainsi, sensibiliser sur l’invisible et préserver la santé.
Avoir un mandat politique, ça m’a permis d’être volontaire en ce qui concerne le repérage des zones humides, de faire le point et de protéger ces secteurs-là. Ça a été un travail extrêmement riche. Car même en connaissant la commune, on arrive à découvrir des pentes et des points d’eau. Ça n’avait jamais fait tilt, avant. On a réussi à en faire une carte, ce qui permet de voir le départ du bassin versant.
Découvrir et comprendre notre territoire
Je me souviens d’images qui sont quand même impressionnantes. Découvrir que, quand vous plantez un bois de résineux, type épicéa, et bien le tout petit cours d’eau qui est en dessous devient complètement mort. Plus une herbe ne pousse. D’ailleurs, on est allé chercher les anciens. On discutait assez librement et il y a un qui a dit « Bien sûr, il n’y a plus rien, il n’y a plus d’herbe, il n’y a plus de fleurs, donc il n’y a plus d’insectes et il n’y a plus de truites ». Ils avaient le souvenir d’être aller pêcher dans ce ruisseau. Et eux, en ramassaient des truites pour les manger, bien sûr !
Quand on a fait ce travail, il y a des agriculteurs qui sont venus. D’ailleurs, il y en a un qui, aujourd’hui a fini son activité et a pu céder toutes ses surfaces à quelqu’un qui travaille en bio. Une fois qu’on sait, on peut mettre des règles ensemble. Ils nous ont raconté ce qui avait changé. Par exemple, ils nous ont expliqué ce qui s’est passé avec la mécanisation. Pour passer les moissonneuses, les champs n’étaient pas assez larges à cause des haies et des pommiers. Ils ont dû faire sauter ces haies pour passer. Avant, ils avaient des systèmes pour bloquer l’eau. Ils avaient des techniques de travail liées à l’expérience. Ils ont dû changer pour s’adapter. Maintenant, sur un terrain en pente et qui est à nu, quand il y a des gros orages, l’eau ruisselle et descend. Et ça, eux comme nous, on le voit. Je pense honnêtement qu’une jeune génération arrive et voit autrement. Comme dans les années 1940, il y a un conflit entre les jeunes et les vieux.
Je ne sais pas ce qu’on a réussi à mettre en œuvre, mais je crois qu’on ne peut que passer par la sensibilisation sur le terrain. D’ailleurs je pense, que sur la commune, les zones humides sont rentrées dans la tête des gens. Il a fallu dire : « Nous on est au début [du bassin versant], donc si on pollue, ce sont les autres, derrière nous, qui ramassent tout ». Ce n’était pas visible aux yeux de tous. C’est ceux qui sont d’un certain âge qui ont pu dire ce qu’il y avait avant. Il s’est donc passé quelque chose. Il y a une logique par rapport au sol qui est en train de disparaître.
Une démarche volontaire et participative
Il n’y a pas eu de conflit, mais on n’a aucun moyen pour interdire. Du coup, on a fait une démarche volontaire et participative, sur le recensement des zones humides. Lors de ces réunions, j’ai vu des gens qui avaient la même vue, mais de là à pouvoir prendre des décisions sur les secteurs privés…! On ne peut pas imposer, mais il faut sensibiliser sur le terrain, faire comprendre et motiver. Ce n’est pas parce qu’il y a des subventions qu’il faut agir. La question est : est-ce qu’on en a vraiment besoin ? Car c’est le danger qui fait bouger.
Des oppositions ? Certains n’ont pas été volontaires [pour réaliser cet inventaire des zones humides], mais ne nous ont pas empêchés de le faire.
Il ne faut pas dire « C’est comme ça. » C’est comme avec les enfants. Il faut prendre le temps d’expliquer et apprendre aux gens à chercher par eux-mêmes. Prendre le temps de dire pourquoi. Car ce sont eux qui réfléchissent, ce sont eux qui font la démarche et ce sont eux qui seront d’accord avec les résultats. Leur faire découvrir et leur faire voir sur le terrain, ça peut changer les choses. Il faut que ça vienne de la base. On voit qu’il y a des gens que ça intéresse. Dans les ateliers, ça a permis d’écouter ce que pensaient les autres. Il faut une certaine méthode pour faire parler, donner un avis, prendre le risque d’une opposition.

Le temps du dialogue est du temps de gagné – Entretien avec Paul Perras
Maire de Nuelles, dans le département du Rhône, Paul Perras est Président du Syndicat de Rivières Brévenne- Turdine, qui regroupe 48 communes. Il retrace les enseignements d’une concertation avec les acteurs du territoire et notamment avec les agriculteurs concernés par un projet de barrage visant à limiter le risque d’inondation et qui a conduit à une évolution sensible du projet initial (voir l’étude de cas « La gestion du bassin versant Brévenne Turdine » et cet autre entretien vidéo avec Paul Perras.
Entretien réalisé par Hélène Cauchoix.
J’ai horreur du conflit. Je suis plutôt dans le consensus. Mais j’ai mes idées, j’aime arriver au bout et les concrétiser le plus possible. Je ne sais pas le faire dans le conflit, j’aime mieux la concertation, le dialogue et le partage. C’est ma conviction, ma ligne de conduite et ma manière de fonctionner. Je suis comme ça sur mon exploitation agricole donc j’ai fait pareil en tant qu’élu. C’est ma philosophie de vie.
Prendre le temps du dialogue, de l’explication et de l’écoute
On a pu mener une opération importante sur le territoire avec la construction d’un barrage. Et ce c’était pas gagné d’avance. On avait des agriculteurs dont certains venaient de subir une expropriation à cause de la construction d’une zone d’activité. Nous, on passait derrière et on allait encore leur emprunter du terrain, puisqu’on qu’on achetait la bande support du barrage. Il y a des conventions pour les inondations, mais tout le reste, ils en demeurent propriétaires et ils ont des nuisances. Et pourtant, on a réussi à faire passer le message. La dernière fois qu’on s’est retrouvés sur le terrain, moi j’étais très fier, car ils étaient porteurs du projet. Et ça, ça fait plaisir ! Ca veut dire que non seulement on a réussi à faire partager le projet, mais en plus, ils en sont devenus des acteurs à part entière. Et ce n’était pas gagné dès le départ. Dans cette démarche-là, on avait un objectif et pourtant on est allés au-delà de cet objectif. Donc, le temps du dialogue est du temps de gagné.
Notre chance, c’était de démarrer après un échec. Du coup, il n’y avait pas d’intérêt politique pour le syndicat, on a pu constituer notre équipe et le faire à notre manière. Avec la responsable du syndicat de rivières, on a commencé en prenant notre bâton de pèlerin. On est allés voir tous les maires du secteur. Lorsque le président se déplace et parle, ce n’est pas le même impact. On parle d’élus à élus. On a vraiment fait une démarche de terrain pour expliquer le rôle du syndicat, sa position et tout. On avait le bon message et on a pris le temps, même avec les institutions. Effectivement, on a passé beaucoup de temps, mais on a été récompensés en retour parce que les gens avaient compris les objectifs, la démarche du syndicat. On a créé un climat, une écoute, une confiance et un langage commun. Et donc, on n’avait plus de gens qui nous mettaient des bâtons dans les roues. Au contraire, quand ils avaient des problèmes concernant l’eau, ils venaient vers le syndicat. On est devenu vraiment un acteur de la concertation. On a une image de « besogneux » et une reconnaissance qui fait qu’aujourd’hui, on est appelés à mener des concertations pour des sujets qui ne sont pas au cœur du syndicat. D’une certaine manière, c’est de la démocratie participative, mais plus « naturelle » que politique.
Il faut rester humble, fidèle à ses objectifs : garder une ligne de conduite et s’y tenir. Et puis avoir un discours de vérité, tout simplement. Même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. C’est ce mélange qui fait qu’on garde une certaine crédibilité.
Une concertation réussie crée de la coopération entre acteurs du territoire
Prenons par exemple, la coopération qui existe aujourd’hui entre le syndicat de rivière et les agriculteurs. Évidemment, même si je suis agriculteur, on était sur deux mondes en opposition permanente, sur plusieurs sujets, et surtout autour de l’eau. Les agriculteurs ont besoin d’utiliser l’eau et, nous nous étions sur un objectif de la gérer mieux. Il y avait quelques divergences de vues. On a travaillé sur l’achat de matériel agricole, on a monté une opération avec des financements Europe et Région. Une opération où on s’est donné du crédit. Avec cette nouvelle image, autre que l’application de la réglementation, ça nous a ouvert pas mal de portes.
Comme dans toute action politique, il faut un pilote, quelqu’un qui tient l’avion. Modestement j’ai essayé de le faire. Après, quand les gens ont compris la démarche, très vite ça adhère.
Je pense qu’avoir eu une responsabilité politique dans un domaine qui n’est pas lié à mon activité professionnelle, cela m’a donné de la crédibilité, par rapport à une étiquette de militant ou spécialiste. C’est d’ailleurs plus confortable en tant qu’élu, car on ne part pas avec des idées préconçues et on ne rentre pas dans la technique.
D’ailleurs, l’action politique ne peut être conduite que si elle est partagée. Ce n’est pas parce qu’on est élu que nous détenons les vérités. Il faut convaincre les gens, partager pour trouver une vérité commune. Ce temps de concertation, de partage, n’est pas un temps de perdu, car on le regagne dans l’action.
On ne fait pas ce qu’on veut. On est dans une société avec des règles et on ne peut pas s’en affranchir. Il faut faire prendre en compte tout ça. En mettant tout le monde autour de la table au service d’une cause commune, on a gagné l’énergie qu’on aurait pu dépenser en se querellant.
Entretien recueilli par Hélène Cauchoix avec la participation de Betty Cachot, 2018.

La concertation, on y pense souvent trop tard – Entretien avec Annick Cressens
Maire de Beaufort sur Doron, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération Arlysère, Conseillère départementale de Savoie déléguée au développement durable, Annick Cressens a expérimenté le dialogue territorial dans deux situations : un projet de déviation routière et l’aménagement des abords d’un barrage. Elle présente ici un retour d’expérience d’une élue engagée sur son territoire.
Moi, j’adore l’action publique. Mener un projet communal, c’est juste passionnant. Maire, Présidente de la communauté de communes puis Conseillère départementale… Je me retrouve avec beaucoup de casquettes. Malgré le fait d’être sensibilisée et formée à la concertation, j’y ai toujours pensé trop tard. Parce qu’au sein d’un conseil municipal, on a des projets et on est dans l’action.
La concertation, on y pense souvent trop tard
On avance, on avance et tout d’un coup on dit « zut, la concertation ! ». Ce n’est pas encore dans notre mode de pensée, ça ne vient pas d’emblée. On y pense toujours quand ça bloque.
Par exemple, sur le village d’Arêches, on avait monté un gros projet. Comme tous les villages, il est saturé par la circulation. On a un projet de déviation qui contourne le village. On y travaille sur le plan technique, la faisabilité, etc. Et bien évidemment, ça impacte des terrains privés. Donc, on rencontre les propriétaires pour leur présenter notre projet et forcément, il y a des blocages. Pourquoi on n’a pas concerté plus tôt ? J’appelle X, un professionnel de la concertation. Je lui demande d’intervenir, mais il me répond « Votre projet est tout ficelé, moi j’aurais pu intervenir avant, pour construire le projet avec les habitants ». Effectivement, c’était une évidence de dire ça, sauf qu’on y a pensé trop tard. Du coup, pas de concertation, on va rentrer dans une DUP (Déclaration d’Utilité Publique), on va exproprier, etc. Et évidemment ce n’est pas satisfaisant, d’abord parce que ça rallonge les délais et puis ça crée des tensions, des frustrations. C’est dommage. Car notre objectif, c’est bien d’améliorer la vie du village. Avec la concertation, je ne sais pas si les propriétaires auraient accepté le projet, mais au moins on aurait tout fait pour les associer et les mettre en confiance.
Car c’est toujours pareil : sur le plan général, tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut une déviation. Sur 600 habitants, le projet impacte 5 familles, qui au final, ont l’impression de payer pour les autres. C’est vrai, mais en même temps il faut bien qu’on passe quelque part et on passera toujours chez quelqu’un.
Il faut construire le projet avec les gens, pour qu’ils comprennent nos objectifs et nos choix. Car forcément, quand on construit un projet, au début on a tous les possibles. Puis petit à petit, on resserre en fonction des critères que l’on a : techniques (la pente est à plus de 10% donc, non), financier (on choisit évidemment l’option qui coûte le moins cher), réglementaires (c’est une zone protégée donc on ne peut pas…). Au départ, on a tous les possibles et, petit à petit, en fonction des critères qui s’imposent à nous, on arrive à une solution. C’est jamais la meilleure, mais c’est la moins mauvaise. Si les gens comprenaient cette espèce d’entonnoir, ils comprendraient mieux pourquoi on arrive chez eux et pas chez le voisin.
La concertation, cela améliore l’acceptation du projet
Le second avantage, c’est l’acceptation plus probable du projet. Quand on participe à ce processus, on comprend et on accepte. Parce qu’on a le temps, le temps du processus : au début on n’est pas content, mais après il y a ça, ça, ça… Et on arrive à accepter les choses. Quand on arrive avec un projet ficelé et « boum » ça s’impose, les gens n’ont pas le temps de s’habituer à ce projet et de le mentaliser.
En tant qu’élu, on se sent bien dans ce processus de concertation, car on se sent moins seul. Quand on est dans un processus de concertation, on a une responsabilité partagée sur un projet, puisque chacun a sa place. Ça réduit ce sentiment d’isolement qu’on peut avoir en tant qu’élu et notamment quand on est Maire. C’est une responsabilité collective. Ce projet n’est pas le projet du Maire et du Conseil municipal, c’est le projet d’un groupe d’habitants, d’acteurs… Ça enlève les tensions et ça partage les responsabilités.
Sur un autre projet, qui consistait en l’aménagement des alentours d’un barrage, on a fait une concertation, pas tout de suite justement. Quand on a vu qu’il y avait un blocage, on a fait de la concertation et ça s’est bien passé. A l’origine, avec l’élu référent environnement, on était très contents d’aménager le barrage, d’en faire un site emblématique. On était fier de notre idée. Donc, on organise une réunion avec les agriculteurs pour leur présenter notre bonne idée. Puis « Mesdames, messieurs les agriculteurs, qu’en pensez-vous ? » Et là, un agriculteur se lève et nous dit : « Vous nous prenez pour qui ? On ne vous a pas attendu pour aménager le site, vous pouvez repartir ». Ça a été une vraie douche froide, alors qu’on arrivait avec un projet, rien de précis. Je ne m’attendais pas à ça, car ce n’était pas un sujet polémique. C’est alors qu’on est partis sur une concertation. On y croyait, donc on ne voulait pas s’arrêter comme ça. Une fois que la parole a été prise lors de cette réunion, personne n’a plus osé rien dire. Mais, lors de la concertation, tous ont été contactés et ont pu s’exprimer. On s’est rendu compte que tout le monde n’était pas opposé au projet. Du coup, les opposants ont été moins virulents. Pris individuellement, ça a créé une ambiance de travail plus sereine, surtout du dialogue. Ce n’est pas pour rien que ça s’appelle du dialogue territorial.
Ça a bien fonctionné, car c’était un projet pluripartenarial : la commune, EDF, les acteurs du territoire et quelques extérieurs. C’est une expérience positive donc ça donne envie de la reproduire. On touche à ces questions qui reviennent beaucoup actuellement de démocratie locale : comment faire participer les habitants au processus de développement de leur territoire ? Il ne s’agit pas d’élire un conseil municipal, de lui déléguer une responsabilité et de leur dire : « Maintenant vous vous débrouillez ». Comment ce conseil municipal travaille-t-il avec la population qui lui a donné – ou pas – son suffrage pour un développement concerté ?
La concertation, ce n’est pas un coût ni une perte de temps
Ce qui pourrait être négatif, c’est que ça prend du temps. Sauf que, lorsqu’on regarde globalement une action, le temps qu’on perd en amont dans la concertation, on le gagne après. Car de toute façon, les gens s’opposeront au projet. Ils ne pourront pas s’y opposer définitivement, mais il faudra lancer de nouvelles procédures qui prennent du temps, de l’énergie, de l’argent. Donc le temps est perdu après.
Attention, ça ne s’improvise pas d’animer une concertation. Je pense qu’il faut être extérieur, pas impliqué pour ne pas être pris à parti ou manquer d’objectivité. Il faut du recul et un savoir-faire, il faut donc un animateur extérieur. Faire appel à un bureau d’étude extérieur, ça coûte de l’argent. Comme ce n’est pas dans la culture aujourd’hui, ce n’est pas facile de faire adhérer l’ensemble du conseil municipal. Alors que l’argent et le temps qu’on dépense en concertation, on le gagne après. Mais dans un projet communal c’est plus difficile à faire rentrer cela dans notre culture, dans notre budget. Alors, on y pense souvent trop tard.
Il y a des limites à la concertation
Il y a un point qu’il faut verbaliser c’est la question de la décision. On peut avoir toutes les concertations que l’on veut, au bout du compte c’est quand même le conseil municipal qui décide. Et ça, il faut le dire d’emblée, ne pas donner d’illusions aux gens. Car après, on est un peu sur un marché de dupes. Il faut arriver à dire « On construit ensemble, mais la finalisation de ce projet passera par une décision du conseil municipal qui ne sera pas forcément la décision que vous souhaitez. » Mais on pourra expliquer cette décision, c’est le rôle de la délibération qui rend compte d’un argumentaire. Il ne faut pas créer de frustration, il faut que les choses soient claires. Si on n’explique pas bien les choses, ça peut entraîner une démobilisation des habitants. « On a discuté, on a dit plein de choses, on a fait des réunions et au bout du compte, vous avez décidé l’inverse de ce qu’on a dit. On ne reviendra plus discuter avec vous ».
On ne peut pas faire de la concertation sur tout. On peut le faire pour les projets de développement de la commune, car ça concerne les gens et ça a un impact sur leur quotidien. Mais certains projets sont très réglementaires. Même nous [les élus], on nous demande de prendre la décision, mais en réalité ce n’est pas nous qui la prenons : c’est la loi, c’est l’État. On ne fait que se conformer à la loi. Pour tout ce qui est réglementaire et légal, il n’y a pas de concertation. Mais il faut faire de l’information, expliquer que ça s’impose à eux [les habitants] comme à nous.
Il faut un cadre pour un dialogue efficace entre l’élu et les habitants
Il est important que l’élu participe au dialogue pour qu’il y ait un contact direct avec les habitants. Et pour que les habitants entendent les contraintes qui s’imposent aux élus et réciproquement. C’est peut-être plus difficile à entendre, mais c’est aussi pour enrichir notre réflexion, car on n’est que 19 [élus] autour de la table. Sur un sujet précis, c’est important de prendre le temps. Il ne faut pas qu’il y ait l’intermédiaire des techniciens, car c’est aux élus d’être en relation avec les habitants. Ce sont eux qui les ont élus.
Il me semble qu’en tant qu’élus, nous sommes là de par la volonté des habitants et nous les représentons. Nous devons donc avoir un lien direct avec eux, au quotidien, et aussi sur tous les projets de développement que nous mettons en œuvre au sein du conseil municipal. Ce lien, il faut l’organiser pour enrichir notre réflexion, pour gagner du temps et pour avoir des projets qui répondent réellement aux besoins de la population. Pour toutes ces raisons, il me semble qu’il faut arriver à organiser cette concertation. La meilleure façon de le faire, c’est dans ce cadre qu’on appelle le dialogue territorial.
Propos recueillis par Hélène Cauchoix avec la participation de Géraldine Gallice, 2018.

Les citoyens attendent de la concertation qu’elle influe effectivement sur les décisions publiques – Entretien avec Etienne Ballan
Quel est le contexte actuel de la concertation environnementale?
Le plus marquant au cours des années 2010 est le retour de la conflictualité environnementale. On constate également une forte contestation des dispositifs de concertation, non pas pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils produisent. Le lien entre concertation et décision est très insuffisant aux yeux d’une part importante de la population.
Pourquoi ce retour des conflits ? Une de mes hypothèses est la suivante : les pratiques d’éducation à l’environnement mises en œuvre depuis 20 ans ont accru la sensibilité des jeunes générations envers l’environnement alors que le monde des décideurs n’a pas évolué de la même façon et que les objectifs économiques restent prioritaires dans de nombreux choix d’investissement. Du coup, les attentes ne se concrétisent pas et les oppositions se radicalisent. Il y a donc un effet générationnel. Les jeunes sont animés d’un idéal en matière d’environnement, validé par la société et reconnu pertinent par les médias et par l’actualité. Parallèlement à cela, l’idéal démocratique a également progressé dans la société, en France comme dans les pays arabes ou dans de nombreux autres pays, alors que les pratiques démocratiques ont peu progressé et que les modes de prise de décision n’ont sensiblement pas bougé.
Il me semble évident qu’il existe une forte demande sociale de participation. La concertation est voulue par la population, les citoyens sont très concernés par tout ce qui touche à leur cadre de vie et souhaitent donner leur avis et contribuer aux choix qui sont effectués.
Malgré cela, les élus locaux maintiennent des comportements qui ont été forgés durant une période faste, l’Etat peine à évoluer, la crise bouscule les rapports de force et questionne les aspirations démocratiques. Le recours au référendum est le réflexe des politiques pour suppléer aux carences de la participation. En conclusion, le contexte est assez incertain.
Les pratiques de concertation ont-elle évolué significativement ?
Oui, au cours des dernières années, on a assisté à d’importants efforts de consolidation procédurale et méthodologique de la concertation. C’est le cas par exemple de la procédure du débat public. Cependant, ces efforts sont contredits par :
- L’accueil plutôt tiède qu’en fait la population, qui juge principalement la concertation à ses résultats sur la décision publique et non pas (ou pas seulement) à la qualité de son processus de mise en œuvre ;
- La demande d’innovation méthodologique, principalement demandée par les élus locaux pour se distinguer et construire leur image, ou par les services des collectivités pour attirer de nouveaux publics ; il est difficile à la fois d’innover en permanence et de consolider les acquis.
- Des réticences qui tiennent à la crainte de stabiliser, de standardiser, de figer, voire de bureaucratiser la concertation.
Or, il est nécessaire de stabiliser des pratiques ou au moins des principes méthodologiques.
Pour le citoyen, la contribution effective de la participation à la décision publique est une question de crédibilité. Certes, faire la preuve que des acteurs locaux bien intentionnés et guidés par de bonnes méthodes sont capables de bien gérer l’environnement est une chose importante. Mais l’enjeu de la concertation ne s’arrête pas là : il s’agit d’une question démocratique, du vivre ensemble.
Les associations de protection de la nature sont réticentes envers la diffusion des pratiques de concertation car elles craignent que les objectifs environnementaux ne se diluent dans la concertation, notamment face à d’autres enjeux comme l’enjeu démocratique.
Quels sont les enjeux pour l’avenir ?
Aujourd’hui, il y a plusieurs questions qui constituent des enjeux pour la concertation.
- L’inclusion des simples citoyens, c’est-à-dire le fait d’aller au-delà de la participation des parties prenantes
- Le changement de mode de décision publique. Les pratiques innovantes de demain sont celles qui apportent des réponses à la question du partage du pouvoir. C’est cette dimension qui doit, à mon avis, être mise en avant.
- Diffuser, généraliser. Comment ? Avoir une collection d’exemples est utile mais après ?
Propos recueillis en 2016 par Pierre-Yves Guihéneuf

L’effacement de l’Etat contribue à renforcer les conflits d’environnement – Entretien avec Laurent Mermet
Entretien
Quel est le contexte actuel de la concertation environnementale ?
La principale évolution que je perçois au cours des années 2010, c’est la multiplication des conflits d’environnement, due principalement au délabrement du secteur de l’environnement (administration et associations) alors même que les pratiques de concertation se sont elles-mêmes fortement développées mais finissent par trouver leurs limites.
Au cours des dernières années, la concertation a connu un fort développement :
- la concertation institutionnelle a atteint un certain degré de maturité. Elle est maîtrisée par les maîtres d’ouvrages comme par les associations, ce qui lui permet de jouer son rôle de façon relativement satisfaisante ;
- la « petite » concertation, qui vise à créer de la coopération entre acteurs locaux autour d’enjeux communs, est entrée dans la culture commune. « Mettre les gens autour de la table » est désormais un réflexe largement partagé par les acteurs locaux.
Progressivement, le discours sur la concertation et la participation du public est devenu un discours dominant y compris sur le plan international. Cela a apporté beaucoup et les compétences se sont développées. Il existe même tout un secteur qui est devenu un promoteur inconditionnel de ce discours, au point que l’on promeut parfois la participation du public y compris quand ce n’est pas justifié. C’est devenu un discours vendeur.
De ce fait, ce n’est plus une innovation et, comme tous les discours dominants, il alimente une idéologie et il crée du déni.
Quelles sont les limites des processus de concertation ?
L’idéologie consiste à croire ou à faire croire que la coopération est possible dans tous les cas. Il est difficile, mais nécessaire, de distinguer les situations qui ont un potentiel de coopération et celles qui n’en ont pas. Les situations distributives permettent de s’engager vers la recherche de solutions gagnant-gagnant par la voie de la concertation. En revanche, certaines situations sont porteuses d’une dimension adversative irréductible qui suppose finalement un arbitrage politique ; c’est le cas notamment quand certains acteurs ont pour projet de s’approprier ou de détruire des biens auxquels d’autres acteurs sont attachés. Dans ce cas, il n’existe pas de solution gagnant-gagnant et l’affrontement fait partie du jeu politique.
Le déni, cela consiste à qualifier de coopération ce qui n’en est pas et de développer, derrière cette mise en scène, des stratégies de résistance face aux revendications en faveur de l’environnement ou des stratégies qui privilégient clairement l’économie aux dépens de l’environnement. Un exemple d’organisme qui arbore ce faux-nez de la concertation est l’Institution patrimoniale du Haut-Béarn, à propos de la protection de l’ours dans les Pyrénées.
On touche donc aujourd’hui aux limites de la coopération et aux effets pervers d’un discours général qui n’admet pas de se voir limité à un domaine de pertinence particulier.
L’enjeu aujourd’hui est donc de distinguer les situations où il est possible d’envisager des coopérations gagnant-gagnant et les situations où ce n’est pas possible. Les deux cas existent. Il n’est pas facile de distinguer ces situations ex-ante mais il faut essayer de le faire et la façon dont on mène cette instruction est elle-même intéressante. Il faut également évaluer ex-post pour distinguer les vraies et les fausses concertations. En postulant que cette distinction est inutile et que la coopération entre acteurs du territoire est toujours possible quelles que soient les situations, on risque de se faire instrumentaliser.
Quelles sont les sources des conflits d’environnement ?
La montée en puissance de la conflictualité environnementale est le fait majeur de ces dernières années et tout laisse à penser que ce phénomène va s’accroître dans les années à venir.
La cause principale en est l’affaiblissement du secteur de l’environnement depuis 2007. Les réformes politiques ont conduit à un démembrement progressif de l’administration environnementale et à une réduction des aides publiques aux associations. Ces deux phénomènes ont considérablement fragilisé les acteurs de l’environnement.
La capacité des associations à entendre et faire remonter les plaintes formulées par les citoyens et la capacité de l’administration environnementale à instruire ces plaintes constituaient un système d’écoute de la société par le pouvoir politique et fournissait un cadre d’expression aux mécontentements. Peu à peu, les réformes successives ont détruit ces canaux de dialogue et de contre-pouvoirs. Le ministère de l’Environnement a vu ses moyens se réduire considérablement et se fait de plus en plus l’écho des projets d’aménagement portés par exemple par le ministère de l’Equipement. Les associations ont perdu une grande partie de leurs moyens d’action. Pour moi, cette situation est très grave.
Au même moment, le gouvernement s’engage dans une politique de relance économique basée sur des projets « top-down » et néglige les initiatives « bottom-up », y compris dans le champ économique. Cela génère inévitablement des contestations, comme on l’a vu pour des projets comme l’aéroport Notre-Dame des Landes, le barrage de Sivens ou le projet de Center Parc de Roybon.
Avec la rupture du canal d’écoute et de recours qui avait été mis en place antérieurement, les citoyens sont condamnés, soit à se soumettre, soit à engager des conflits sur le terrain. Le recours à la justice n’est pas toujours une solution car en France, l’arbitrage final est politique et non pas judiciaire. Or, le pouvoir politique prend clairement parti en faveur des projets.
En eux-mêmes, les conflits d’environnement ne sont pas un problème, le problème réside dans les conflits perdus pour la cause de l’environnement et dans la violence que cela entraine. Même quand la coopération n’est pas possible et qu’un arbitrage politique doit être rendu, il importe que cet arbitrage soit précédé d’une instruction rationnelle, donc contradictoire.
Et dans l’avenir ?
Je ne suis pas très optimiste pour l’avenir. Les chocs portés par les projets imposés mettent à mal les dynamiques de coopération qui peuvent se développer sur les territoires. Les associations sont démunies face à la contestation car elles manquent de moyens et ne savent pas à qui s’adresser. Dans ce contexte, il est assez logique que l’on voie se développer une contestation radicale et que des activistes parfois violents en tirent parti.
Aujourd’hui, nous n’en sommes qu’au début de la montée en puissance des conflits environnementaux. Quoi faire ? Il est urgent d’ouvrir des espaces de réflexion au sein du monde de l’environnement car ses capacités d’action sont réduites quasiment à zéro. La faiblesse actuelle des associations est le résultat d’années de réformes publiques. Il faut néanmoins travailler avec elles car elles sont le principal acteur de ce secteur, mais l’appui des fondations est important.
Propos recueillis en 2016 par Pierre-Yves Guihéneuf

La concertation doit contribuer à créer du commun – Entretien avec Laurence Monnoyer-Smith
Quel est le contexte actuel de la concertation environnementale ?
On peut constater un double mouvement depuis le début des années 2010, c’est-à-dire depuis la mise en place des lois Grenelle.
D’un côté, un approfondissement des formes et des dispositifs de participation dans les territoires, avec le développement des chartes de la participation, l’activité des Conseils de développement, la mise en place de services dédiés à la participation dans plusieurs collectivités, etc.
On peut dire que nous sommes passés d’une période d’expérimentation à une période de mise en œuvre régulière, d’inscription de la participation dans le fonctionnement courant de certaines organisations, de retours d’expériences et de certaines formes de capitalisation.
Ces évolutions sont dues à plusieurs facteurs : les actions de formation menées au cours des dernières années, l’activité d’associations et de réseaux comme l’Institut de la concertation, de la Commission nationale du débat public, etc.
D’un autre côté, des résistances face à la concertation
Du côté réglementaire, la situation actuelle se caractérise par une grande instabilité juridique et des textes trop nombreux. Cela provoque une radicalisation du discours de certains acteurs, au premier rang desquels les maitres d’ouvrages qui ont besoin de visibilité et de simplicité, mais pas seulement : les associations et les citoyens s’en plaignent également. Ce plus, ce droit pléthorique ne garantit en rien le résultat en terme de protection de l’environnement et de qualité des projets.
On a trop souvent tendance à légiférer et à complexifier. Il est urgent de passer à autre chose : cesser de produire de la réglementation dans le domaine de l’environnement et dans celui de la participation, stabiliser le droit actuel voire le simplifier ; produire de la « soft law » c’est-à-dire des incitations non réglementaires, par exemple en développant les bonnes pratiques ; enfin, mettre en place des dispositifs agiles, souples.
Quel est l’enjeu du développement des pratiques de concertation ?
La demande sociale de concertation est réelle. On la perçoit clairement sur le terrain. Elle vient des citoyens, des associations, des syndicats, des élus locaux… La société civile demande à pouvoir donner son avis en amont des décisions mais également à ce que ces avis soient écoutés, prise en considération. Les concertations de façade créent des réactions désabusées et « anti-système », alimentent les théories du complot et contribuent à radicaliser les rapports sociaux.
Il y a actuellement dans la société un déficit d’horizon commun mais en même temps une soif de vivre-ensemble, d’espoir, d’optimisme et de projets. Les jeunes sont trop souvent absents des processus de concertation alors que ce sont eux qui peuvent exprimer cela et le traduire en projets. Les entreprises également attendent que des histoires et des avenirs se dessinent sur les territoires : elles en ont besoin pour se projeter, entreprendre et innover.
Les territoires peuvent être des lieux de mobilisation, de reconstruction du lien, de la coopération, de synergies public-privé. La concertation doit contribuer à créer du commun. Pour cela, les initiatives locales de coopération sont décisives. L’Etat doit également participer à ces dynamiques, en adoptant un rôle d’animateur.
Propos recueillis en 2016 par Pierre-Yves Guihéneuf

La concertation sert-elle la cause de l’environnement ou de la démocratie ? – Entretien avec Loïc Blondiaux
Le dialogue entre les acteurs locaux sert-il l’environnement ?
La création d’espaces locaux de concertation permet à des acteurs qui sont porteurs de préoccupations environnementales de se faire entendre. Ceux-ci peuvent difficilement en faire l’économie, ils n’ont pas toujours un accès facile aux médias. Sans ces initiatives locales de concertation, on risque fort de négliger les enjeux environnementaux.
Pour autant, la concertation sert-elle la cause de l’environnement ? Je comprends que certaines organisations environnementalistes, qui ont des moyens limités, puissent se poser la question de la « rentabilité » de leurs investissements, notamment humains, dans la concertation. Mais je dirais que la concertation ne peut pas être jugée seulement sur sa valeur extrinsèque, c’est-à-dire sur ce qu’elle produit, par exemple sur l’environnement. Elle a aussi un intérêt intrinsèque : elle favorise le dialogue et légitime les décisions, quelles qu’elles soient. On ne peut pas demander à la concertation de promouvoir l’avis de minorités contre l’avis de majorités. Les avis minoritaires doivent évidemment être entendus, mais la concertation n’a pas le pouvoir de renverser les rapports de force. Par exemple, si localement une population est majoritairement opposée à l’installation d’éoliennes, elle va trouver dans la concertation une tribune pour faire connaître son point de vue.
On peut aussi se demander si la concertation, la co-construction, la recherche de compromis est la seule façon de servir l’environnement ? Une participation des habitants qui prendrait un tour conflictuel ne peut-elle pas aussi servir l’environnement ? Aujourd’hui, les acteurs porteurs d’un souci envers l’environnement sont infiniment plus faibles que ceux qu’ils affrontent. Dans un tel contexte, le conflit ne peut-il pas être aussi productif que le consensus ? C‘est une question à laquelle je n’ai pas la réponse.
Quelles sont les spécificités des concertations environnementales par rapport à l’ensemble des démarches participatives ?
Les citoyens à titre individuel ne sont pas toujours très présents dans ces scènes de dialogue, au contraire de ce qui se peut se passer par exemple en milieu urbain dans les initiatives de démocratie participative, alors que les collectifs organisés le sont.
Mais la gouvernance partagée des biens communs est bien une démarche de démocratie. Il faut résister à la tentation de « faire du nombre ». Il est préférable de se demander si tous les intérêts, les points de vue, les expériences sont bien représentés. Pour cela, il n’est pas indispensable de rassembler le plus largement possible et il est ainsi possible de cartographier, d’identifier la diversité des points de vue. Il est certain que la diversité des intérêts doit être recherchée au sein des processus de dialogue.
Il faut aussi que le dispositif de concertation soit évolutif et puisse intégrer des protagonistes qui auraient pu être oubliés. Enfin, il est possible, au cours d’un processus qui mobilise d’abord des parties prenantes, d’ouvrir ponctuellement des espaces à un plus large public.
Mais il faut considérer comme légitime le fait que des citoyens ne se mobilisent pas en masse pour débattre d’enjeux pour lesquels ils ne se sentent pas concernés. Certains chercheurs, comme Guillaume Gourgues, dénoncent avec raison l’obsession du quantitatif chez certains promoteurs de processus participatifs.
Cette vision de la concertation suppose évidemment que l’on fasse passer au second plan l’objectif de l’empowerment des citoyens, au profit de l’objectif d’une décision plus partagée et plus pertinente. Ces deux objectifs sont légitimes, mais il est très difficile de les poursuivre concomitamment, il faut le plus souvent faire un choix.
Quels sont les acquis et les résistances à la concertation ?
Au cours des dernières années, je note des évolutions contrastées.
D’un côté, une diffusion des pratiques, leur inscription dans le fonctionnement de certains organismes, la professionnalisation des praticiens, l’émergence d’un certain « état de l’art » de la concertation qui fait globalement consensus. On note aussi la reconnaissance de la capacité d’imagination et du niveau de réflexion de la société civile, qui me semble plus forte qu’autrefois. La participation apporte des idées nouvelles, rares sont désormais ceux qui ne le reconnaissent pas et qui estiment par exemple qu’une concertation ne leur a rien appris. Enfin, dans une société où le rôle de l’Etat tend à s’affaiblir, on note un intérêt croissant pour les communs, le partage, l’horizontalité. Tout cela met le dialogue et la gouvernance au centre des processus.
D’un autre côté, des oppositions anciennes perdurent et d’autres apparaissent. En premier lieu, on note que les préjugés sur la concertation demeurent, malgré les progrès de certaines institutions publiques, entreprises ou collectivités. Cet « arrière-plan » culturel contribue à entretenir l’inertie. Ce n’est pas surprenant car les pratiques de concertation ont véritablement pris de l’expansion depuis une quinzaine d’années seulement, ce qui est peu de temps à l’échelle des changements politiques et sociétaux.
On peut noter également une contestation radicale de la démocratie représentative, qui se situe dans une histoire ancienne mais qui est portée plus récemment par les zadistes ou les Indignés. Certains chercheurs estiment que cette contestation dépasse ces cercles restreints et que le principe même de la représentation politique, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse parler au nom des autres, est questionné par un nombre toujours plus grand de citoyens. Je ne sais pas si c’est vrai, mais dans l’affirmative, cela remettrait profondément en cause le mode de fonctionnement de notre démocratie. Quoi qu’il en soit, la crise de confiance entre élus et citoyens tend à s’aggraver plutôt qu’à se résorber. Les élus en sont généralement conscients et tentent d’être vertueux même si, parfois, ils ne peuvent s’empêcher de jouer avec les règles. Leurs écarts provoquent, de la part de certains mouvements citoyens, des condamnations qui sont parfois de nature morale : on les accuse de manque de loyauté, par exemple.
Quels sont les enjeux pour l’avenir ?
L’un des enjeux est de renforcer la crédibilité des processus de dialogue. Il est souvent utile que des tiers extérieurs comme des garants ou des animateurs interviennent pour sécuriser les espaces locaux de dialogue. C’est d’autant plus nécessaire que les rapports de force sont inégaux, que des lobbies locaux ont un réel pouvoir d’influence sur l’administration et sur les élus, que les Préfets – qui y jouent souvent un rôle actif – ne sont pas porteurs d’une culture de la concertation.
Un autre enjeu est de changer d’échelle. Comment dépasser la juxtaposition de petites concertations locales – fussent-elles réussies – pour produire un effet politique à la hauteur des enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui ? La notion de « communs » peut-elle constituer un thème fédérateur et inciter à ce changement ?
Enfin, si se confirme la tendance actuelle à l’affaiblissement du rôle de l’Etat et à la réduction des budgets publics, on peut s’attendre à ce que la société réagisse en se mobilisant autours de projets locaux, d’initiatives multiples, de systèmes d’échange, etc. La coopération et la notion de bien commun pourraient gagner en importance. C’est ce que pensent certains chercheurs comme Michel Bauwens. Cependant, la prolifération d’initiatives citoyennes ne crée pas nécessairement de la démocratie et ne réduit pas les fractures sociales. On peut très bien imaginer, comme dans le cas de la Silicon Valley, un modèle de développement qui fasse une large place aux innovateurs sociaux, à la mise en réseau et au partage, à l’horizontalité, tout en laissant dans la marginalité une partie importante de la société. Une société post-étatique peut-elle être démocratique ? Comment repenser le rôle des pouvoirs publics dans un contexte d’affaiblissement de l’Etat ?
Propos recueillis en 2016 par Pierre-Yves Guihéneuf

