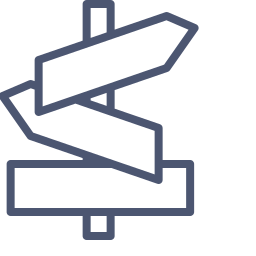
ambitions pour la participation citoyenne pour 2026
Présentation du guide au CESE et en distanciel, le 13 octobre 2025, avec nos intervenants :
- Cécile Gintrac, Géographe, Institut la Boétie
- Erwann Binet, Responsable de la mission Démocratie ouverte à la ville de Lyon, élu et ancien député.
- Loïc Blondiaux, Chercheur en sciences politiques, co directeur du Master Ingénierie de la concertation (Sorbonne), membre du CA de l’ICPC.
- François Jegou, Consultant et chercheur en design de politiques publiques, fondateur de Strategic Design Scenarios.
- Léa Galloy, Cheffe de projet – Démocratie d’interpellation pour la transformation écologique et sociale au sein de l’Institut Alinsky
- Sylvain Raifaud, Elu à la Mairie de Paris, membre de Paris collectif
- Bruno Cristofoli, Adjoint à la démocratie participative à Saint-Médard en Jalles, co-fondateur de Fréquences communes
Les enjeux
La pratique de la participation citoyenne se construit depuis bientôt 25 ans en France. Elle a connu des avancées importantes (à travers notamment les lois de 2001, de 2012, de 2016 et les pratiques associées) qui se sont matérialisées par l’émergence de professionnel.les dans les collectivités, les services de l’Etat, les entreprises de conseil et le monde associatif. De plus en plus de Français ont été en et sont en présence de dispositifs de participation qui s’enrichissent et s’emboitent.
La démocratie participative s’est installée dans le paysage politico-administratif avec différentes formes de démocraties, qui coexistent, via une palette diversement mobilisée selon les échelles, les volontés politiques ; un corpus de professionnels formés et avec des savoir-faire identifiés dans nombre d’institutions ; un éco système qui s’est organisé, un marché d’ingénierie spécialisée constitué. Le champ de la participation est à la croisée de la transition environnementale, des changements de comportements et des modes de vie, de l’inclusion et de la vitalité démocratique de la société, mais elle ne peut pas porter sur ses épaules l’objectif de résoudre les maux de la société.
Alors que les élections municipales de 2014 et 2020 se sont fortement focalisées sur la place des citoyens et la participation citoyenne comme moteur de nouveauté et d’innovation démocratique, pour les équipes se présentant devant le suffrage des électeurs pour les élections municipales, des inquiétudes se font jour, de la part des praticien.nes, d’un risque de retour en arrière et de balayage, voire de rejet de la participation citoyenne… En effet, certains discours au niveau national, identifient que la participation citoyenne prendrait trop de temps face à l’impérieuse nécessité de ré industrialisation ou remettent en cause le long et important travail de structuration du débat public et de positionnement des garants de la Commission nationale du débat public. Ce peut aussi être le cas au niveau local, sous couvert d’urgence climatique, il peut être tentant de balayer rapidement le travail complexe et parfois inconfortable du dialogue territorial…
D’autres indiquent aussi que, finalement, la participation citoyenne ne servirait pas à grand-chose, réunissant « toujours les mêmes » et n’étant pas en capacité de transformer les institutions locales et nationales : son efficience pourrait être remise en cause, d’autant qu’elle ne permettrait pas le nécessaire renouveau démocratique.
Ces critiques sur l’efficacité et l’efficience de la participation citoyenne sont à prendre en compte pour s’interroger, évoluer, mais il apparait essentiel d’identifier comment la structuration de la participation a permis d’avancer dans les organisations et comment la renforcer.
Il est temps de faire le point, pour que ces pratiques nécessaires (mais non suffisantes) au renouvellement démocratique, se renforcent encore.
Les prochaines élections municipales de 2026 en sont l’occasion ; en interpellant les listes qui se présenteront, sur la place qu’elles comptent faire à la démocratie participative / délibérative. Cela doit permettre de s’interroger sur les différentes formes de démocratie à faire vivre dans l’espace public, le positionnement des (futurs) élus vis-à-vis de celles-ci et l’évolution de l’administration que cela suppose.
Le conseil d’administration de l’institut de la concertation et de la participation citoyenne souhaite creuser le sujet et faire le point avec les membres de son réseau, composé de chercheurs, praticiens, publics et privés, membres d’associations… et ses partenaires, pour identifier les avancées et poser les jalons pour 2026 et la prochaine décennie.
Car nous avons la conviction que des graines de transformations ont été posées, ont germé et qu’il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin pour renforcer la place des citoyens dans notre démocratie, notamment au niveau local.
Les objectifs
L’objectif est d’identifier les impacts de la participation citoyenne, au sein des organisations locales et nationales, ainsi que les sujets qui sont devant nous pour approfondir et améliorer ces impacts : quelles sont les avancées qu’aurait permises la participation citoyenne en termes organisationnels, d’élaboration de prise de décision, d’inclusions des publics dans leur diversité, de sincérité et de transparence des démarches, de reddition des comptes… et surtout, quelles pistes poser pour progresser dans l’ouverture démocratique et la transformation de nos organisations et des politiques publiques, à l’aune des élections municipales de 2026 ?
Nous avons noté 3 sujets transversaux qui interrogent directement la transformation de l’action publique :
L’évolution de l’administration
La question de la prise de risque et de l’innovation organisationnelle dans une chaine hiérarchique, avec la place des agents des services publics de terrain, dans leur relation aux citoyens et à la hiérarchie ; la place des cabinets et la relation au politique, la place du juridique et des finances…
Le positionnement des élus dans le renouveau démocratique
Traditionnellement les élus décident ; mais aujourd’hui l’élaboration de la décision est, de fait, plus collaborative, contributive. Avançons-nous vers une posture d’élus animateurs du dialogue territorial et avec l’entrée des expressions citoyennes devenant commanditaires de l’administration ? Comment cela se traduit-il ? Comment les listes citoyennes tricotent-elles l’organisation municipales lorsqu’elles arrivent aux manettes ?
Les différentes formes de démocraties
Délibérative, contributive, du faire, d’interpellation, voire directe… s’excluent-elles ou s’emboitent-elles ? A quelles conditions ? Est-ce que l’approche des communs, l’organisation des tiers-lieux vient renforcer l’engagement et la participation ? Ces espaces sont-ils porteurs de nouveautés démocratiques ? A quelles conditions ?
Et 5 focales :
- La traçabilité de la construction des prises de décision et leur explication dans un monde complexe, incertain, qui fait appel à de multiples expertises et contraintes :
2. L’évaluation participative de la participation :
3. La capacité à mettre en débat des avis contradictoires, l’accueil du conflit, l’organisation de la controverse, pour construire du dialogue et du compromis, entrer en négociation :
- Montrer l’influence de l’expression / préconisation citoyenne dans une prise de décision
- Montrer les contraintes multiples et contradictoires
- Comment se prend une décision ?
- Pourquoi, comment ? Quels questionnements évaluatifs (de la qualité démocratique à l’efficacité – efficience des démarches sur la décision).
- L’évaluation est-elle réalisée régulièrement ?
- Comment l’évaluation est-elle prise en compte ?
- Comment fait-on sans moyens ?
- L’organisation structurée des termes du débat public (avec notamment la qualité de l’information et la contradiction) ; l’articulation des scènes de débat : citoyennes, médiatiques (RS), techniques, expertes, politiques
- La reconnaissance et la traçabilité du conflit par les institutions : pourquoi, comment travailler avec des collectifs qui ne reconnaissent pas l’institution ?
- Mais aussi les conditions de mise en place et le traitement des interpellations citoyennes, par exemple…
4. La place d’un tiers, d’un garant, des garanties de la participation, telles qu’imaginées par l’ICPC, voici 10 ans, et mises en œuvre au niveau national et avec des collectivités et entreprises, par la CNDP :
5. La reconnaissance de l’engagement :
- Ce type d’approche est-elle dédiée uniquement aux « grandes » concertations ?
- L’intérêt (ou pas) de la place d’un tiers, de la médiation, la séparation entre commanditaire et garant…
- Comment progresser au sein des petites collectivités sur ce sujet ?
- L’accueil, l’accompagnement et l’outillage de l’expertise citoyenne
- La place des associations et des instances pérennes et l’articulation avec l’expression citoyenne
- L’indemnisation des citoyens, la formation ? des citoyens
- L’apprentissage de la citoyenneté à l’école, dans le monde du travail
Les Grands entretiens
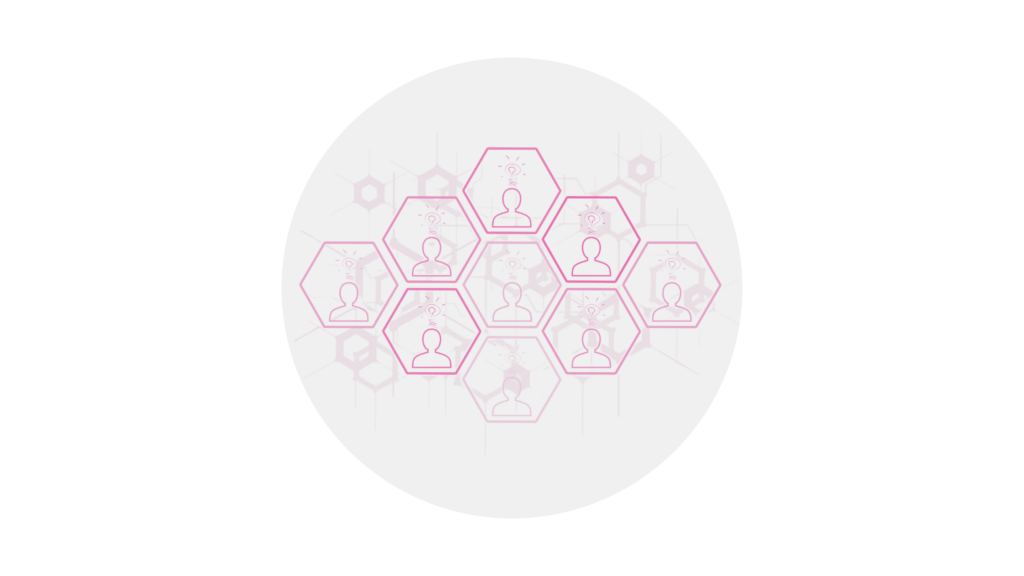
Fanny Lacroix, maire de Châtel en Trièves et vice-Présidente de l’Association des maires ruraux de France, réalisé le 16 décembre 2024.
Pascal Clouaire, Vice-Président en charge de la participation citoyenne de Grenoble-Alpes Métropole et commissaire de la Commission nationale du débat public (CNDP), réalisé le 14 janvier 2025, de 13 h à 14 h
Ombelyne Dagicour, 1ère adjointe de la ville de Poitiers, en charge de la démocratie locale, de l’innovation démocratique et de l’engagement citoyen,réalisé le lundi 27 janvier à 11 h.
Anouch Toranian, adjointe à la ville Paris, en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, réalisé le 13 mars 2025 à 13h.
Une conférence internationale
Retour sur la conférence organisée dans le cadre de Truedem : les innovations démocratiques peuvent-elles vraiment améliorer la confiance politique ?
Des « Conversations entre »

Pour s’enrichir et faire un pas de côté avec des chercheurs et des experts, des conversations avec des praticien.nes pour une démocratie participative en lien avec les évolutions de la société
Comprendre les formes d’engagements dans une société morcelée – 17 avril de 13 h à 14 h
Yannick Blanc, Président de Futurible international et vice-président de la Fonda et: Elian Belon, membre du CA de l’ICPC
Comprendre la relation des citoyens à la politique – 30 avril de 13 h à 14 h
Camille Bedock, chargée de recherche CNRS, chercheuse à Sciences Po Bordeaux et Christophe Beurois, membre du CA de l’ICPC
Et accédez au document présenté par Camille Bedock : https://i-cpc.org/document/presentation-camille-bedock-conversation-entre/
Comprendre les dynamiques des quartiers populaires – 11 juin de 13 h à 14 h
Julien Talpin, Chercheur en science politique au CNRS (Ceraps/Université de Lille) et Pascal Jarry membre du CA de l’ICPC
Comprendre la démocratie d’interpellation – 16 juin de 13 h à 14 h
Co portage avec l‘Institut Alinsky

Antoine Gonthier, doctorant et ville de Grenoble et Julie Blanquet, chargée de mission résilience et innovation territoriales, département de la Gironde
Des Ateliers

Pour relever des défis, les écrire ensemble et poser les leviers et les conditions de mises en œuvre pour réussir les démarches de demain
Écrivons un programme pour les municipales !
Lors des Rencontres européennes de la participation, présentiel, le 18 mars, Strasbourg
Proposons un programme pour les municipales, avec au cœur la participation citoyenne !
L’idée est de construire, sous forme de jeu, un programme pour les municipales avec au cœur la participation citoyenne.
La semaine de la démocratie et de la participation à Lyon
Dans le cadre de la semaine de la démocratie et de la participation organisée par le Comité des allié.es à Lyon (semaine du 7 avril au 11 avril)
Atelier défis le mardi 8 avril de 18 h 30 à 20 h 30
Relevons 3 défis pour la participation citoyenne aujourd’hui et demain
Co portage Truedem/Sciences po Grenoble et ICPC, le 22 avril, en visio 12 h 30 – 14 h
Nous sommes dans un moment où les citoyens sont en défiance avec la politique, les institutions, la démocratie telle qu’elle est proposée aujourd’hui. A quelles conditions la participation citoyenne peut-elle être un levier pour réduire la défiance, aider à renouer avec la confiance des citoyens envers la/le politique, les institutions ?
- Introduction sur la question de la confiance aujourd’hui en Europe, en France et au niveau local par Frédéric Gonthier, enseignant chercheur en sciences politique et porteur scientifique national du projet Horizon Europe TruEDem.,
- Puis sous forme d’ateliers, travail sur 3 défis
Atelier défis à Angers
A Angers / avec l’ICPC 49 , le 2 juin, présentiel à l’hôtel du Département 13 h 30 – 16 h 30
Atelier défis à Nantes
A Nantes / avec l’ICPC 44 , le 5 juin, présentiel de 16 h à 18 h – Dans le bâtiment « Atlantica » (ex l’UNe), 21bd Doumergue, Nantes (En face de la guinguette du Belvédère, arrêt de tram Vincent Gâche)
Atelier défis à Rennes
A Rennes/ avec l’ICPC 35 , le 11 juin, en présentiel aux Ateliers du vent
Hackathon : la démocratie participative en danger ?
Hackathon organisé avec Sciences Po Rennes les 3 et 4juillet pour Identifier des solutions innovantes aux défis de la participation citoyenne, en mobilisant la complémentarité des étudiants en science politique et en design de service public.
Les étudiants ont travaillé sur le défi du bien vivre sur le territoire et sur le défi de la prise en compte du vivant non humain.
Atelier défis à Poitiers
Cet atelier défis a été organisé dans le cadre des Rencontres des listes participatives organisées à Poitiers du 21 au 24 août 2025 par Actions communes.
Atelier défis à Toulouse
Cet atelier défis a été organisé dans le cadre des Rencontres des conseils de développement organisées à Toulouse du 24 au 26 septembre 2025, par la CNCD.
