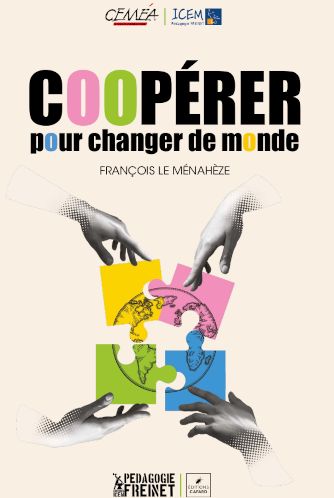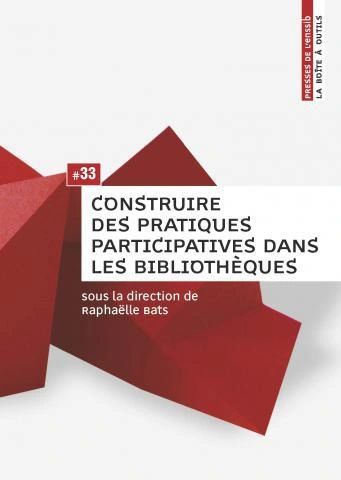« Décider et Agir – L’action publique face à l’urgence écologique », le tout premier ouvrage du réseau du Lierre....
Livre
Livre
Pour contrer les niveaux généralisés de désengagement des citoyens à l’égard des institutions politiques, ce livre examine les innovations démocratiques...
Communs et territoires Expériences de dialogue sur l’eau et l’alimentation Gérer les communs, l’expression est devenue… commune. L’eau possède...
Dans notre société démocratique, comment s’exerce le droit reconnu à toute personne d’accéder aux informations et de participer à la...
En défendant le principe de Sécurité sociale de l’alimentation, les auteurs montrent qu’une démocratie dans l’alimentation pourrait être le fondement...
Dans notre société démocratique, comment s’exerce le droit reconnu à toute personne d’accéder aux informations et de participer à la...
Passer de la réflexion à l’action en personne et en ligne Cet ouvrage vise à sensibiliser le public aux transformations...
La question se pose à tous les niveaux : comment se sortir de cette société de compétition et de concurrence...
Écologie et Démocratie Joëlle Zask Collection Générale 240 pages Publié le 10 février 2022 Ce livre est disponible en librairie...
Arpège et l’Afnor vous proposent pour cette fin d’année 2023, un livre blanc dédié à la Gestion de la Relation...
ABSTRACT The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance explores the concepts, methodologies, and implications of collective intelligence for...
Les grands projets inutiles et imposés et plus récemment le mouvement des Gilets jaunes, la colère contre le 80 km/h...
Et si on réinventait notre manière de concevoir la ville ? La participation citoyenne nourrit fondamentalement la fabrication de la...
Désormais accessible dans l’ensemble des librairies spécialisées, cet ouvrage collectif, co-dirigé par Florence Crouzatier-Durand et Virginie Donier, propose pour la...
Le dialogue entre acteurs du territoire est-il favorable à l’environnement ? Plus de concertation, est-ce que cela produit plus de...
Récit de l’expérimentation « Territoires d’engagement » – Agence Nationale de la cohésion des Territoires et ALGA Médiation. À travers ce carnet...
Et si le féminisme était une clé pour renouveler nos démocraties ? Dans son essai « La démocratie féministe », Marie-Cécile Naves...
« Comment s’orienter dans une époque marquée par des bouleversements écologiques sans précédent, auxquels, manifestement, ni les États ni le capital...
Le guide « La mairie est à vous ! » contient l’ensemble des fiches outils développées par le réseau Actions communes pour...
Participer et faire participer les citoyens, les publics ? Qui participe, comment et jusqu’où ? Que devient le professionnel avec...
Éditions de l’Atelier, 21 avr. 2023 – 264 pages Comment sortir d’un modèle de consommation et de production intoxiqué par...
Transformative Participation for Socio-Ecological Sustainability. Around the CoOPLAGE pathway We, as humans, are currently facing urgent socio-ecological challenges (climate change,...
Mis en lumière par la chercheuse Elinor Ostrom à la fin du XXe siècle, les communs sont un modèle de gouvernance à...
Ces derniers mois les contestations contre les Zones à faibles émissions (ZFE) ont pris de l’ampleur. Les métropoles, chargées d’interdire...
Face à la dégradation croissante de la situation écologique et sociale, avec une probable montée en radicalité des mouvements de...